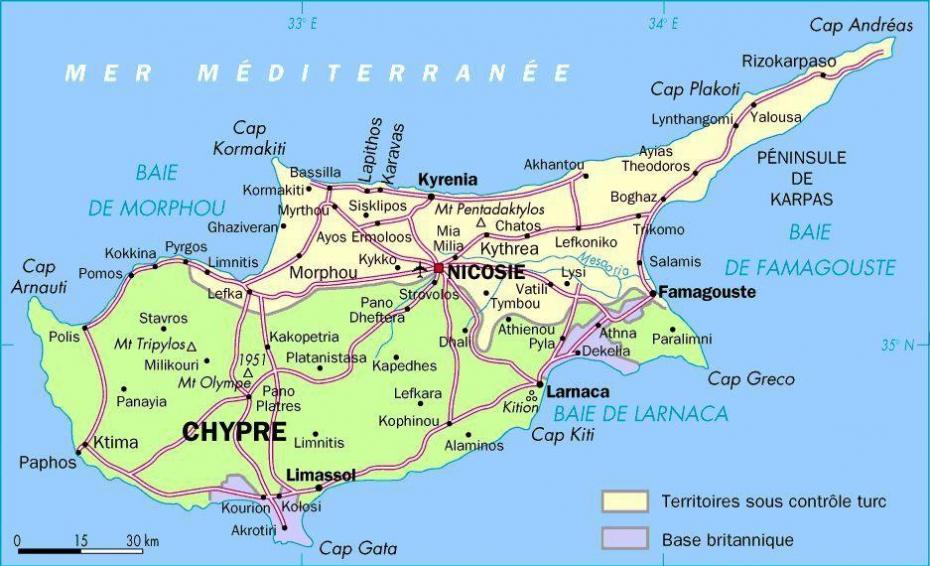Lettre de La Vigie du 29 novembre 2023
La mer Rouge et son grand jeu
Artère vitale du commerce international, particulièrement nécessaire aux Européens, la mer Rouge connaît des dynamiques stratégiques locales entre riverains, régionales avec les zones contiguës mais également mondiales, puisque les grands acteurs (États-Unis, Chine, Russie) y interviennent plus ou moins activement. Seule l’Europe prête peu d’intérêt à la zone. Vous avez dit géopolitique ?
Pour lire l’article cliquez ici
Monaco juché sur son rocher
Poursuivons le tour d’horizon des voisins terrestres la France en explorant la principauté de Monaco. Se rapprochant progressivement de la France en quête d’un protecteur, ce n’est qu’en perdant la plus grande partie de son territoire que son développement a réellement pu commencer. Aujourd’hui, les rapports sont amicaux et coopératifs, mais la France reste très présente, la souveraineté de Monaco reste relative.
Pour lire l’article cliquez ici
Lorgnette : COP, 28ème du nom
La prochaine conférence des parties (COP) sur l’environnement va s’ouvrir à Dubaï le 30 novembre. Elle poursuit une démarche lancée au Sommet de la Terre en 1992 à Rio et réunit experts et responsables chaque année sous l’égide des Nations-Unies et avec l’aide des experts du GIEC. Elle met en œuvre un protocole de Kyoto (signé en 1995 et ratifié en 2005) où les parties prenantes s’engagent à réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre. L’accord de Paris en 2015 prévoit de limiter le réchauffement climatique à moins de 2°C. L’an dernier à Charm el Cheik, un fonds d’aide au pays pauvres affectés par le changement climatique fut créé.
L’enjeu de cette édition vise la réduction des énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole). Mais le climat stratégique actuel n’est pas propice à un accord international contraignant. Si pour l’UE il faut des engagements clairs de sortie, bien des pays du Sud dépendent encore des énergies fossiles pour leur développement, qu’ils le produisent ou qu’ils en aient besoin pour leur développement.
À côté des conflits en cours ou des luttes géopolitiques sous-jacentes, la mécanique de la négociation internationale est à la peine.
JOVPN
Abonnés : cliquez directement sur les liens pour lire en ligne ou téléchargez le numéro pdf (ici) (ou ici pour la version anglaise), toujours avec votre identifiant/mot de passe. Nouveau lecteur : lisez l’article au numéro, en cliquant sur chaque article (2,5 €), ou alors en vous abonnant (abo découverte 17 €, abo annuel 70 €, abo. orga 300 € HT) : ici, les différentes formules.
Crédit photo : -Reji on VisualHunt