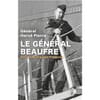Relire Coutau-Bégarie (LV 274)
La Vigie débute le nouveau cycle stratégique de l'automne en se laissant éclairer par l’œuvre de Coutau-Bégarie (Gratuit)
Après avoir relu Beaufre (LV 271) avant l’été, il est bon de débuter le nouveau cycle stratégique de cet automne en se laissant éclairer par l’œuvre de Coutau-Bégarie, homme d’une grande érudition s’il en était.
Nous piocherons ainsi quelques perles dans trois ouvrages : son « Traité de stratégie », son « Bréviaire stratégique » et « 2030, la fin de la mondialisation » afin d’éclairer notre lanterne en ces temps particulièrement désorientants : incursion dans l’espace aérien de l’Otan sans protestation des États-Unis, instabilité politique majeure en France, reconnaissance d’un État de Palestine agrémentée d’une (fort opportune) coopération policière menant à l’arrestation de l’un des commanditaires de l’attentat de la rue des Rosiers (1982), intérêt soudain et répété pour le Groenland… Tous ces événements incitent à se demander quelle est la stratégie des différents pays et alliances existantes.
Pour avoir une stratégie, encore faut-il savoir ce qu’elle recouvre.
Ce qu’est la stratégie
Coutau-Bégarie reconnaît la polysémie du terme, propagée par de nombreux auteurs qui utilisent une définition assez large : « Le général Fiévet donne une définition dont le seul critère est celui de la rationalité, transposable à n'importe quelle activité humaine. La stratégie devient alors un concept attrape-tout, dont le sens est inversement proportionnel à son champ d'application ». (Traité, p. 38).
Le principe de réalité interdisant de restreindre autoritairement le sens du terme, Coutau-Bégarie indique qu’« il faut donc se résigner à la coexistence d'un sens fort, celui qui correspond à l'essence du concept, et d'un sens faible, dont on cerne bien le propos mais dont la logique est floue ». (Traité, p. 39).
Cela le pousse dans son Traité de stratégie (un traité est un ouvrage didactique qui expose de façon systématique un sujet ou une matière) à étudier la stratégie comme concept, catégorie du conflit, science, méthode, art, et enfin en tant que système.
L’étude du concept l’amène à définir la stratégie comme « l'art et la science de l'État au service de la guerre totale ». (Traité, p. 71) et, afin de ne laisser aucune place au doute, il affirme que « si tout est stratégique et la stratégie n'est plus nulle part, la corruption du concept est consommée. La seule manière de sortir de cette ornière est de revenir à la notion d'ennemi et à la dialectique des intelligences qu'elle engendre. Lorsqu'il n'y a pas cette dialectique, il n'y a pas de stratégie ». (Traité, p. 78). Beaufre approuverait sûrement.
Dans la lignée de Clausewitz, il reconnaît que la stratégie est un phénomène articulant action et réaction (Traité, p. 76), car l’ennemi ne reste pas passif lorsqu’il est attaqué. Cela pose un problème à nos pays dans lesquels « on ne parle plus d'ennemi, on raisonne en termes de menace (criminelle, mafieuse, terroriste...) avec le double problème de la quasi-impossibilité de s'accorder sur leur définition et sur la riposte à leur opposer ». (2030, p. 27).
Du fait de l’impossibilité de prévoir exactement ce que l’ennemi fera, alors que beaucoup aimeraient maîtriser les risques et faire de la stratégie une science exacte, il insiste sur le propre de la stratégie, « une logique probabiliste dans laquelle l'information n'est jamais parfaite ». (Traité, p. 97).
Comment elle s’acquiert
Peu de formations à la stratégie existent, sauf quand elles concernent l’entreprise. C’est une cause probable de l’existence de l’idée que le savoir stratégique serait inné chez certaines personnes, possédant ou non une longue expérience des champs de bataille.
Coutau-Bégarie combat cette idée reçue en affirmant que « la règle est que le savoir stratégique s'acquiert et se perfectionne par l'expérience et par le travail intellectuel » (Bréviaire, n° 529), n’hésitant pas à faire témoigner d’illustres capitaines :
- « sur le champ de bataille, l'inspiration n'est le plus souvent qu'une réminiscence. Ce n'est pas un génie qui me révèle tout à coup, en secret, ce que j'ai à dire ou à faire dans une vie inattendue pour les autres, c'est la réflexion, la méditation » (Napoléon, in Traité, p. 28) ;
- « faites bien voir que les qualités du général, du moins en ce qui me concerne, résulteraient de la compréhension, d'un dur travail, d'un esprit toujours à l’œuvre et concentré. Si cela m'était venu facilement, je n'aurais pas si bien réussi ». (Lawrence, in Traité, p. 29) ;
- « la théorie qui veut toujours marcher de pair avec l'expérience se venge tôt ou tard d'avoir été trop négligée » (Kléber in Traité, p. 30) ;
- la palme revenant à l’archiduc Charles pour lequel « on ne devient grand capitaine qu'avec la passion de l'étude et une longue expérience. Cet adage si rebattu de nos jours, que l'on naît général et qu’on n’a pas besoin d'étude pour le devenir, est une des nombreuses erreurs de notre siècle, un de ces lieux communs qu'emploient la présomption et la nonchalance, pour se dispenser des efforts pénibles qui mènent à la perfection ». (Traité, p. 34).
Pourquoi faut-il autant travailler ? Parce que « la stratégie, plus qu'aucune autre science, tire profit de n'importe quelle discipline : elle a besoin des sciences exactes pour évaluer sa base technique ; de l'économie pour évaluer ses moyens ; de la science politique à cause de son rapport intime avec la politique ; de la sociologie pour replacer le conflit dans son contexte global ; de l'histoire pour y puiser des exemples et des enseignements… » (Traité, p. 143).
L’étude est indispensable car le premier problème du stratège « est de reconnaître la nature du problème auquel il est confronté ». (Bréviaire, n° 246).
Mais où sont passés les stratèges ?
Les carences en matière de stratégie, que nous avons précédemment évoquées (LV 268), nous conduisent à nous demander comment trouver des stratèges. Ils n’apparaissent pas grâce à on ne sait quelle opération mystérieuse, ils sont le fruit de leur époque et de leur environnement : « on peut dire que la science stratégique est limitée à des sociétés évoluées, confrontées au risque de guerre, ouvertes à la discussion, tournées vers l'abstraction et gouvernées par la recherche de l'utilité ». (Traité, p. 150).
Peut-être que l’absence de l’une ou l’autre de ces caractéristiques dans nos sociétés est une des raisons de la faiblesse de leur pensée stratégique. D’autant que « la pensée stratégique suppose à la fois une expérience pratique et une propension à réfléchir qui ne se rencontrent pas souvent chez le même homme » (Traité, p. 148).
Si les conditions évoquées sont nécessaires, elles ne sauraient suffire, l’armée britannique l’ayant montré à ses dépens : « L'armée britannique des Indes produit des manuels remarquables mais aucun enseignement n'en est tiré pour l'Europe » (Traité, p. 256), triste constat qui incite le lecteur à se replonger dans les « Trois discours sur la condition des grands » de Blaise Pascal.
Cette rareté des stratèges peut s’expliquer par ce que déclarait Marmont à propos des « principes de la guerre », ces « vérités compréhensibles même par un esprit médiocre mais dont l'application est réservée à quelques esprits supérieurs, parce que leur respect simultané est souvent problématique » (Traité, p. 305) : « les principes généraux pour la conduite des armées sont peu nombreux mais leur application fait naître une foule de combinaisons qu'il est impossible de prévoir et de poser comme règle ». (Marmont in Traité, p. 305).
En prolongeant la réflexion de Poirier sur la stratégie intégrale, la stratégie peut être vue comme un système au sens où l'entend Ellul « un ensemble organisé dont tous les éléments sont en relation constante et qui possède une régulation interne » (Traité, p. 493).
L'intérêt de cette analyse réside dans sa capacité à « rendre compte de cette imbrication entre les facteurs internes et externes ». (Traité, p. 506), le risque étant que le système se veuille autonome et coupe ainsi les ponts avec la politique. Or la stratégie doit lui rester soumise. C’est la politique qui définit le projet et donne la direction générale qui, permet au stratège de définir les effets à produire (Foch) pour atteindre l’état recherché.
Pour conclure
L’étude et la réflexion sont ainsi indispensables à celui qui veut devenir stratège. Pas d’action sans pensée préalable. C’est un véritable défi car « le système technicien est de plus en plus élaboré, il crée une dépendance dont les individus ont de plus en plus de mal à s'affranchir : le système médiatique bloque l'émergence d'opinions dissidentes au profit d'un conformisme mou organisé autour d'un matérialisme compensé par une morale internationale bruyante mais finalement peu opératoire ». (2030, p. 56).
Il faudra donc au stratège du caractère pour imposer la justesse de ses vues dans son propre camp avant d’avoir l’occasion de faire admettre à l’ennemi sa défaite. Cela peut sembler difficile en temps de paix ou plutôt d’attente stratégique au cours de laquelle « il faut maintenir une veille, aussi bien technique que doctrinale, qui permette de faire face, le moment venu, à une modification du système international ». (Traité, p. 516).
Alors, comment faire pour avoir tant une stratégie que des stratèges ? « Aujourd'hui comme hier, toute stratégie dépend d'une part, de la problématique qu'elle se donne, d'autre part, des moyens dont elle dispose ». (Traité, p. 101) Quelle est la problématique et quels sont les moyens ? La question reste ouverte.
Une fois la stratégie définie, il faudra trouver des chefs pour la mettre en œuvre, ce qui n'est pas une sinécure. En effet, « la conduite de toutes ces actions est particulièrement difficile : d'une part, l'absence, le plus souvent, d'ennemi désigné implique de ne plus chercher à vaincre mais à maîtriser un espace de crise en vue de créer les conditions d'une règlement politique, ce qui suppose de ménager la population civile, même massivement hostile » (Traité, p. 519). Et, in fine, que peut-on espérer d’une stratégie européenne ? « Il n'y aura pas d'Europe de la défense, donc d'Europe politique de plein exercice, tant que l'OTAN existera ». (2030, p. 128).
La Vigie honore ici le regretté et prolifique Hervé Coutau-Bégarie comme un maître et s’inspire de ses nombreux travaux. Elle aime raisonner à sa suite en stratégiste (cf. LV 121, équation de la stratégie ; LV 153, le dilemme du stratégiste, LV 171 Une grande stratégie pour la France…).
JOVPN
Pour lire l'autre article du LV 274, Déblocage libanais, cliquez ici