
Comme pour chaque numéro d'été, La Vigie vous propose ses notes de lecture. A acquérir vite avant de partir.
Le pays du lieutenant Schreiber
A. Makine

Que dire d’insolite à propos de Jean-Claude Servan-Schreiber, cousin de JJSS, patron de presse, député, créateur de la régie française de publicité ? Ses années de guerre et de résistance, comme le fait très bien Makine, ancien clandestin devenu immortel. Au-delà de la vie personnelle du « lieutenant Schreiber », nous plongeons dans un monde où la franchise faisait fi du politiquement correct, la bravoure était l’étalon de la morale, qui ne pouvait donc résister à celui de l’ivresse de l’après-guerre qui créa tant de « guerriers retardataires dans un temps de paix peuplé d’indifférents et d’oublieux ». L’indicible expérience du combat n’a-t-elle alors comme seule issue que le silence, la solitude et l’entrée cahin-caha dans un autre monde ? Est-il possible d’écrire correctement sur l’engagement inconditionnel, les combats, le décalage du soldat avec le monde contemporain ? Makine le prouve.
Nous, fils d’Eichmann
G. Anders

Après le procès d’Eichmann couvert par son ex-épouse Hannah Arendt, Anders écrit au fils aîné d’Eichmann deux lettres dans lesquelles il expose que si « la lignée n’est pas une faute, personne n’est l’artisan de ses origines », ne pas réfléchir sur la responsabilité de celui qui incarna « la banalité du mal » est la preuve d’une paresse intellectuelle se drapant dans la piété filiale. Eichmann est significatif d’un monde « en passe de devenir machine » qui ne cesse de rechercher la performance maximale et a dépassé la capacité de l’Homme à le représenter. Ne pouvant se représenter les choses d’une effroyable grandeur, l’Homme ne peut donc maîtriser le monde qu’il a construit. On ne peut rester indifférent à ce monde effroyable car « de nos jours, inversement, c'est l'ignorance (de ce que nous pourrions savoir, mieux, de ce que nous ne pouvons aucunement ne pas savoir) qui constitue la faute elle-même ».
La civilisation des mœurs
N. Elias

Puisque le président de la République a évoqué la « décivilisation », il est opportun de reprendre ce qu’Elias écrivit sur le processus de civilisation. Le concept n’est pas universel car se civiliser visait en France à copier la cour, alors qu’en Allemagne il s’agissait d’édifier une opposition bourgeoise à la cour. De là proviennent les vertus allemandes de sincérité et franchise qui s'opposent à la politesse et la dissimulation françaises.
La civilisation est un « processus qu’il s’agit de promouvoir », par lequel les hommes « refoulent tout ce qu'ils ressentent en eux-mêmes comme relevant de leur nature animale ». Cette auto-contrainte dont les étapes sont le souci de contenir l'émotivité individuelle par la raison, la stricte observation des convenances et le renoncement à toute tournure vulgaire se traduit in fine par un assujettissement et la création d’un comportement privé et public.
Têtes de mules
E. Gendrin, La Boîte à bulles, 2020
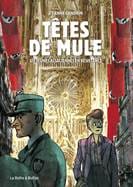
Avec toutes les commémorations des 80 ans de la Libération, il est judicieux de présenter cette bande dessinée indépendante, très poignante. Il s’agit de l’histoire vraie d’un groupe de jeunes filles strasbourgeoises, anciennes guides (le scoutisme et le guidisme étants interdits sous l’occupation nazie), qui entrèrent en résistance dès les premières heures de 1940. Animées par un profond courage personnel et d’une Foi solide, elles ont réussi à organiser d’efficaces filières d’évasion vers la France « libre » et vers la Suisse, avant d’être finalement arrêtées. On suit le destin extraordinaire d’une héroïne en particulier, jusqu’à la fin. Le sujet dramatique est traité avec une vraie finesse, alternant sérieux et humour de manière juste. Le trait subtilement stylisé permet d’ajouter cette nuance de légèreté à une histoire incroyable.
Le Montage
V. Volkoff, Julliard, 1982
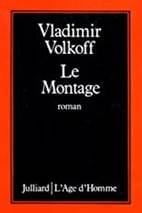
Alors que la guerre d’Ukraine n’en finit plus, que des deux côtés du Dniepr on se réarme, que les vieux spectres de la Guerre froide se réveillent, alors rappelons ce roman, grand prix de l’Académie française en 1982, qui est le roman fondateur de l’agent d’influence. Ironiquement, l’auteur était descendant de Russes blancs, mais avait servi dans les services de renseignement français. On suit un jeune Russe blanc qui est recruté par le KGB et qui passera son temps à influencer l’opinion publique en France, tout en étant téléguidé par Moscou. Manipulation, chantage, espoir, désespoir, tristesse, rage, déception… on observe comment le ballet des émotions emporte le protagoniste, qui cherche un sens à sa vie, ne sachant plus démêler le vrai du faux. Que vaut la vie d’un individu dans le « grand jeu », quand tous les coups sont permis ?
L’Arctique russe, un nouveau front stratégique
J. Radvanyi et M. Laruelle, 2024

L’Arctique russe est un territoire paradoxal, tout à la fois habité et exploité de longue date, tout autant que front pionnier permanent. Océan aussi bien que terres, l’Arctique russe revêt une importance stratégique pour Moscou, la dernière révision de la stratégie maritime russe ayant en 2022 conforté sa place de première zone d’intérêt économique et stratégique. Confronté à des mutations profondes, environnementales comme géopolitiques, cette région est au cœur des enjeux entre Asie et Europe, Chine et Otan. Cet ouvrage, court, agréable et intelligent, nous démontre une fois de plus qu’un grand livre n’est que très rarement un gros livre.
Colère et temps
P. Sloterdijk, 2008
Et si la colère, des individus mais surtout des peuples, était une monnaie ? Si elle pouvait s’accumuler, se transmettre et s’échanger contre autre chose ? C’est en quelque sorte la thèse de P. Sloterdijk qui analyse le rapport à cette émotion qu’est la colère, qui entre dans les cycles de violence depuis les temps immémoriaux. Appliquée à notre époque, l’analyse permet de comprendre la cristallisation des ressentiments, la transformation et l’éruption, des Gilets Jaunes aux Printemps arabes, du 7 octobre à Rising Lion, de mouvements éruptifs. Un livre extrêmement complet pour comprendre certains des fondements de nos civilisations, aussi bien que leur devenir.
Trafalgar la sanglante
F. Clauw, 2021
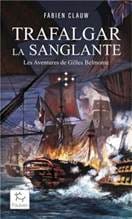
Ce cinquième volume des aventures de Gilles Belmonte dépare un peu des quatre précédents. Rappelons qu’il s’agit d’un roman de marine à voile (ici au temps de la Révolution) mais écrit par un Français et qui tient la dragée haute aux maîtres anglo-saxons du genre, les Forester et O’Brian. Mais alors que les précédents laissaient libre cours à l’imagination, l’audace et le panache, F. Clauw est obligé cette fois-ci de coller à l’histoire. Trafalgar est donc une bataille ratée de peu, la faute à Villeneuve, la faute à Lallemand… Étape incontournable de ce cycle, elle intéresse plus par son côté historique (car on comprend tous les aléas ayant mené à cette bataille) que par le romanesque. Très intéressant. Pour le panache, deux tomes sont parus depuis.
De la grande stratégie
J L. Gaddis, 2023
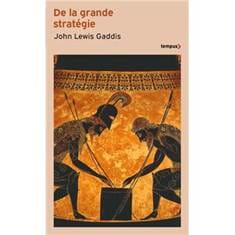
Est-ce de la stratégie ou une méditation historique sur les guerres (occidentales) ? C’est en tout cas très cultivé et le livre se lit très agréablement. Peut-être s’intéresse-t-il plus aux stratèges (Xerxès, Périclès, Octave, Charles Quint, Elizabeth Ière, Quincy Adams, Lincoln, W. Wilson) ou aux philosophes et stratégistes (Sun Tsu, Augustin, Machiavel, Tolstoï et Clausewitz) qu’à la stratégie proprement dite. Celle-ci paraît à ses yeux plus une conséquence qu’un principe moteur : Cet abord vaut le détour.
LV






